Les tribunaux d'instance et de grande instance fusionnent pour devenir "tribunaux judiciaires"
Publié : 30 décembre 2019 à 15h13 par Nicolas Mezil
Ce sont les juridictions de proximité par excellence, traitant les litiges du quotidien: en 2020, les tribunaux d'instance fusionnent avec ceux de grande instance pour former un unique "tribunal judiciaire", avec la promesse qu'aucun site ne sera fermé.
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/radios/alouette/importrk/news/original/5e0a148e5687b4.24942673.jpg)
Cette réorganisation est l'une des principales mesures de la réforme de la justice, promulguée le 23 mars, et aussi l'une des plus décriées, magistrats et avocats s'inquiétant d'une dévitalisation de ces petites juridictions et d'un accès plus restreint au juge.
Depuis l'annonce de cette fusion il y a près de deux ans, la garde des Sceaux Nicole Belloubet invoque la nécessité de "simplification" et de "lisibilité", avec "une porte d'entrée unique à la justice".
Depuis 1958, les tribunaux d'instance (TI) et les tribunaux de grande instance (TGI) se partageaient les contentieux civils, selon une répartition essentiellement fondée sur le montant du litige.
Un nouveau tribunal et un nouveau juge
Héritiers des juges de paix, les juges d'instance - surnommés "les juges des pauvres" - tranchaient toutes les affaires pour lesquelles la demande portait sur des sommes inférieures à 10.000 euros, des expulsions locatives aux dettes impayées, en passant par les travaux mal exécutés et les conflits liés aux accidents de la circulation. Ils étaient également compétents pour les tutelles.
Au 1er janvier, les 285 tribunaux d'instance disparaissent, ainsi que les 164 TGI de France.
Quand un tribunal d'instance est situé dans la même commune qu'un TGI (57% des TI sont concernés par cette situation), ils fusionnent pour former le "tribunal judiciaire". Quand le TI est situé dans une commune différente, il devient une chambre détachée du tribunal judiciaire et est appelé "tribunal de proximité".
Alors que les particuliers pouvaient se présenter directement au greffe du tribunal d'instance pour déposer leur requête, la réforme renforce le recours accru aux procédures dématérialisées et étend la représentation obligatoire par un avocat.
Exit aussi le juge d'instance, qui s'appellera désormais "juge des contentieux de la protection". Il restera un magistrat spécialisé dans les affaires liées aux vulnérabilités économiques et sociales, la garde des Sceaux ayant dû renoncer à supprimer cette fonction statutaire devant la bronca des opposants à la réforme.
Du « flou » selon les syndicats
Quid de leurs compétences ? Les deux principaux syndicats de magistrats dénoncent "le flou" autour de la question.
La loi facilite la création de pôles spécialisés dans les départements ayant plusieurs tribunaux de grande instance et permet d'attribuer des compétences supplémentaires aux tribunaux de proximité pour mieux "s'adapter aux besoins particuliers des territoires", souligne le ministère de la Justice.
Ces ajouts de compétences et ces spécialisations seront décidés par décrets après propositions des chefs de cours d'appel, mais "sans calendrier précis" relèvent l'Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat de la magistrature (SM).
"C'est le plus gros bouleversement. Est-ce que beaucoup de cabinets de juges d'instruction vont être supprimés? De juges d'application des peines? On ne sait pas, on n'a aucune visibilité", tacle la présidente de l'USM, Céline Parisot.
"Nos collègues ne savent pas ce que les chefs de cour ont proposé à la ministre", abonde Katia Dubreuil, présidente du SM, déplorant une "absence de concertation".
(Avec AFP)
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/alouette/images/logo.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/wild_cow_looking_at_camera_in_the_meadow_2025_01_07_06_09_55_utc1765734293732-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/Angers___Palais_de_justice1760016540944_format16by9_webp1765707826237-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/WW_____2025_12_10T160343_0961765379049714_format16by9_webp1765642814740-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/gendarmerie_voiture_20211739178504279-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/Cholet_BAsket1708613014818-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/Jeu_online_Stade_Rochelais_Basket1677593123592-format1by1.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/coupe_de_france_WEB__1_1765462120453-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/ducs_dangers_jeu1728565446801-format1by1.png)
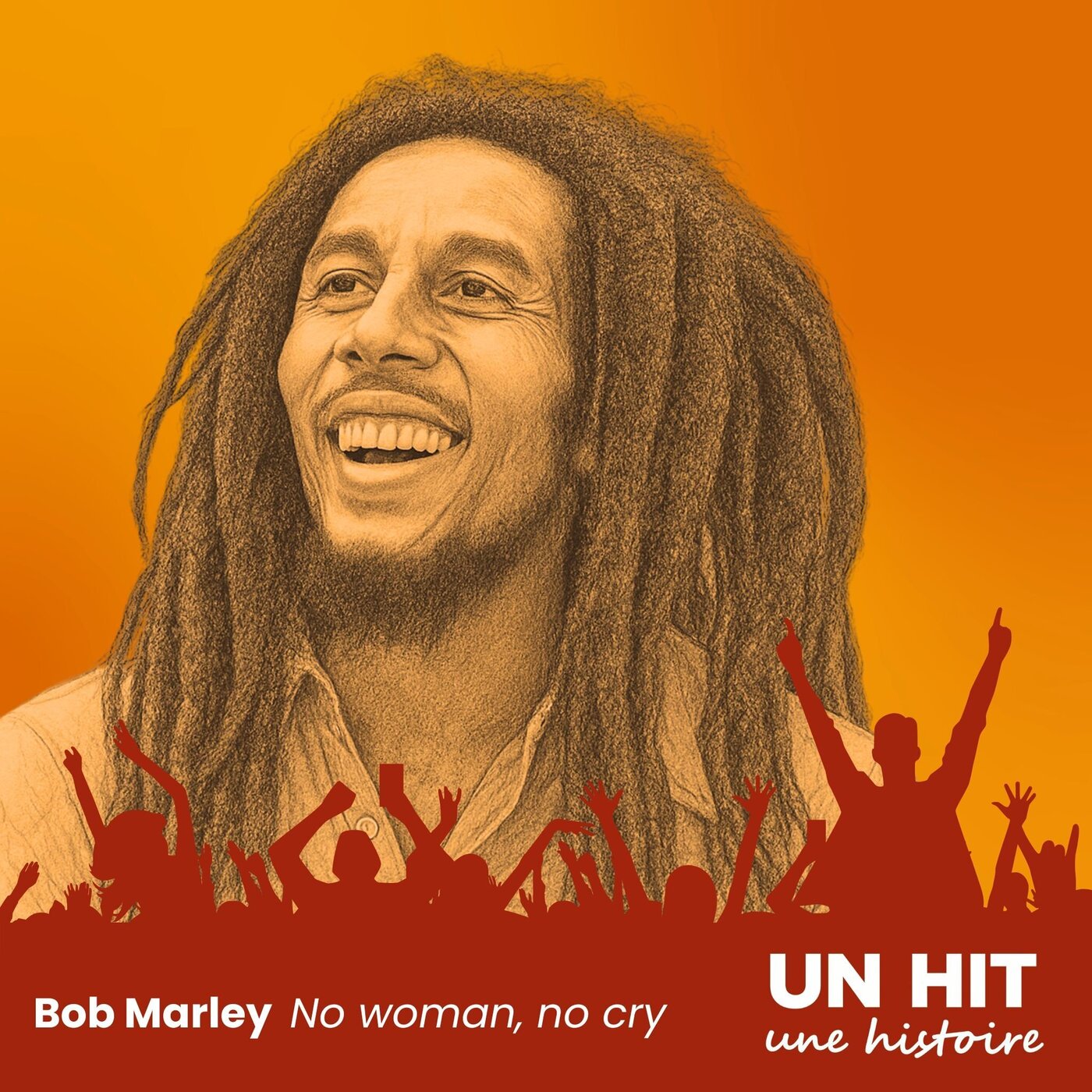

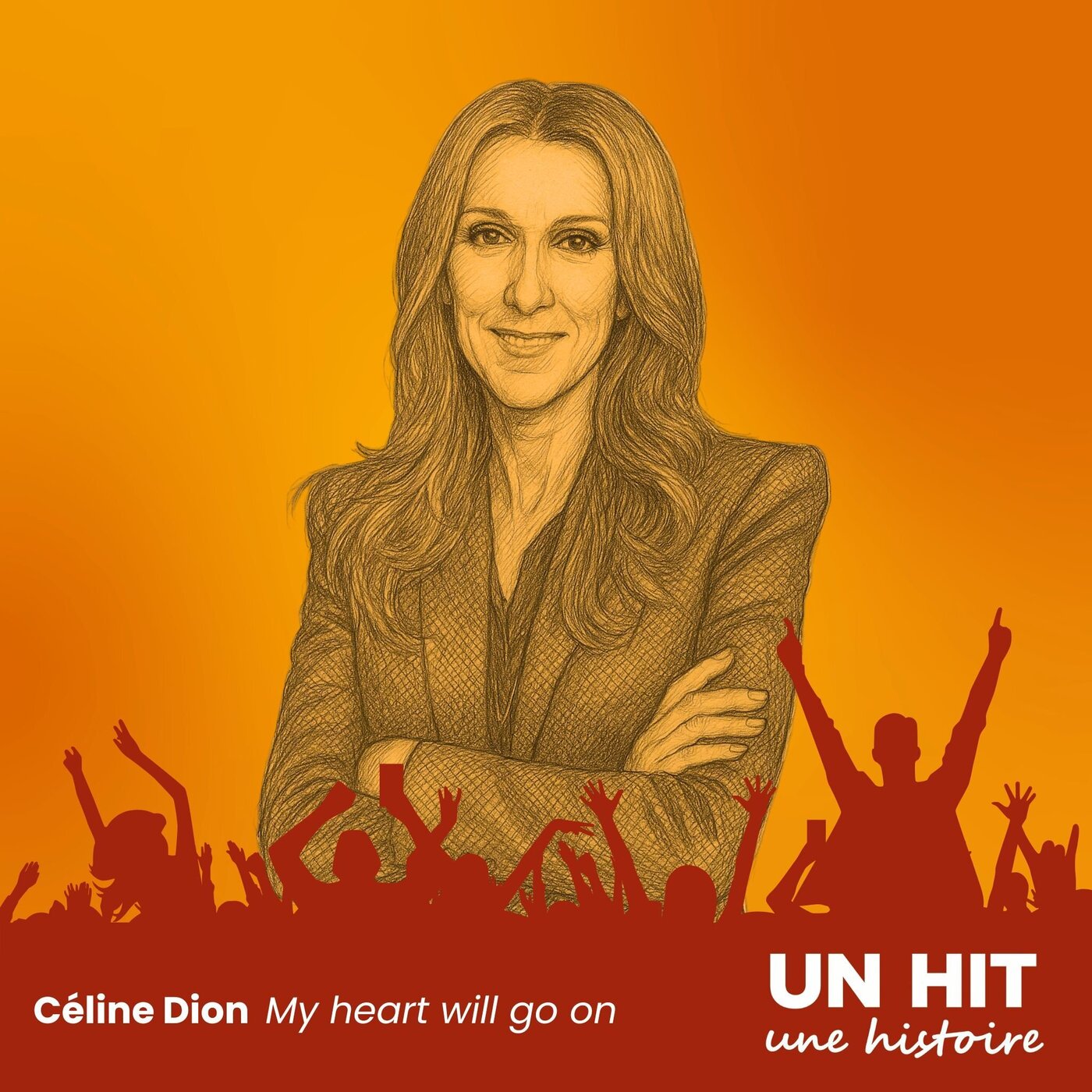

/t:r(unknown)/fit-in/500x281/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/wild_cow_looking_at_camera_in_the_meadow_2025_01_07_06_09_55_utc1765734293732-format16by9.png)
/t:r(unknown)/fit-in/500x281/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/Angers___Palais_de_justice1760016540944_format16by9_webp1765707826237-format16by9.png)
/t:r(unknown)/fit-in/500x281/filters:format(webp)/medias/6cOIUcKx8a/image/WW_____2025_12_10T160343_0961765379049714_format16by9_webp1765642814740-format16by9.png)